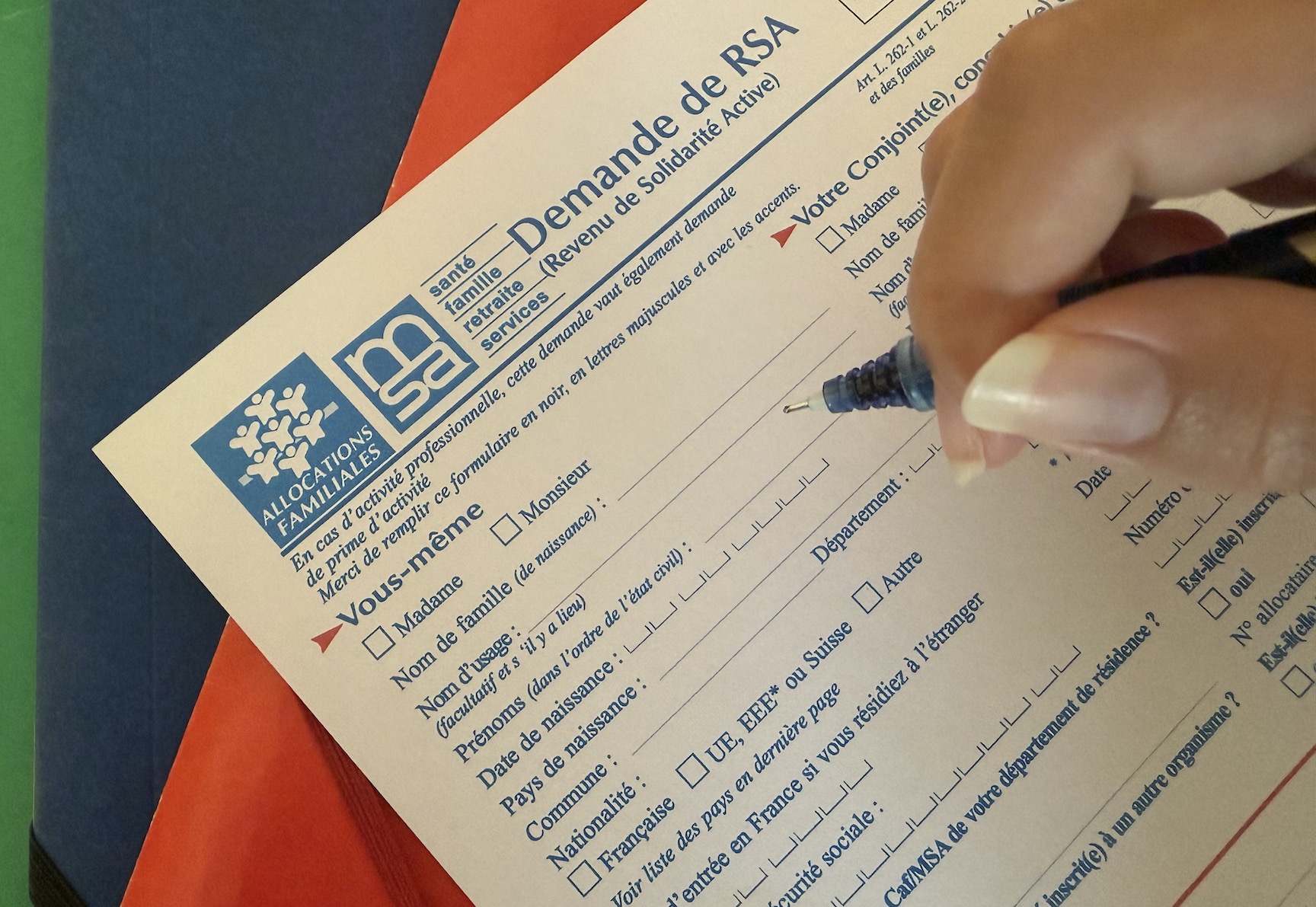Trois questions pour interroger le fantasme français de « l’assistanat »
« Le système d’aides sociales français est tellement avantageux qu’il incite à ne rien faire. »
FAUX
C’est une idée reçue tenace : les aides sociales seraient si généreuses qu’elles dissuaderaient de travailler. Pourtant, les données comparatives de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), analysées par la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques), démontrent exactement l’inverse.
En France, une personne seule sans revenu d’activité perçoit un revenu disponible équivalent à 39 % du revenu disponible médian (RDSM). Cela correspond à environ 820 euros par mois, incluant le RSA et les aides au logement. Ce montant la place en position intermédiaire parmi les pays étudiés, loin derrière des pays comme la Suède (47 %) ou le Japon (46 %).
Mais surtout, le système socio-fiscal français est conçu pour encourager l’activité. Une personne qui travaille à mi-temps au SMIC (soit 50 % du salaire moyen) voit son revenu disponible grimper à 77 % du RDSM. Ce gain de 38 points est l’un des plus élevés d’Europe, preuve qu’il existe un fort incitatif financier à reprendre le travail.
Et ce n’est pas une exception. La France fait partie d’un groupe de pays — avec le Royaume-Uni, l’Espagne et le Japon — qualifiés par la DREES de « systèmes protecteurs garantissant un gain substantiel à l’activité ». Autrement dit : on soutient les plus précaires, mais on soutient encore davantage les travailleurs modestes.
Contrairement au discours dominant, le système français ne piège pas les gens dans l’inactivité : il les aide à en sortir.
« La France est le pays le plus généreux avec ceux qui ne font rien. »
FAUX
Encore une affirmation sans fondement. Selon l’étude TaxBEN (OCDE/DREES), la France ne se situe pas en tête des pays les plus généreux vis-à-vis des personnes sans ressources. Pour une personne seule sans emploi, la France offre 39 % du revenu médian disponible, soit moins que l’Espagne (45 %), le Royaume-Uni (44 %), le Japon (46 %) ou encore la Suède (47 %).
La France n’est donc ni la plus généreuse, ni la moins généreuse. Elle se positionne dans un juste milieu, avec un modèle équilibré : soutenir les plus vulnérables sans créer de trappe à inactivité.
Plus frappant encore : des pays souvent présentés comme plus « méritocratiques » comme les États-Unis (8 %), le Canada (22 %) ou la Pologne (27 %) offrent des niveaux de soutien bien plus faibles. Ce sont des systèmes qualifiés de « peu protecteurs », qui laissent leurs citoyens sans revenus vivre dans la pauvreté.
Loin d’être une anomalie dépensière, le modèle français reflète un choix de société : ne pas laisser sombrer celles et ceux qui traversent une période difficile, tout en favorisant le retour à l’emploi. Une position assumée, mesurée et… très éloignée des caricatures.
« Les plus pauvres se jettent sur les aides sociales. »
FAUX
Contrairement à une idée reçue régulièrement relayée dans le débat public, les personnes en difficulté ne se ruent pas sur les aides sociales. C’est même l’inverse qui se produit : chaque année, des millions de personnes éligibles renoncent à demander les prestations auxquelles elles ont pourtant droit. Ce phénomène, appelé non-recours, est massif et bien documenté par les administrations, les chercheurs et les associations.
Le cas le plus emblématique est celui du RSA : environ 34 % des foyers qui pourraient y prétendre n’en font pas la demande. Cela représente plus de 750 000 ménages et près de 3 à 4 milliards d’euros d’aides non versées chaque année. Ce non-recours s’observe aussi sur d’autres dispositifs. Environ 40 % des bénéficiaires potentiels de la complémentaire santé solidaire (CSS) gratuite ne la réclament pas. Quant à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), elle n’est pas perçue par près de 50 % des personnes qui y ont droit, en particulier parmi les immigrés âgés.
Si l’on additionne les différents dispositifs (RSA, Aspa, CSS, aides au logement, etc.), les estimations officielles indiquent que ce sont entre 10 et 14 milliards d’euros d’aides sociales qui ne sont pas versées chaque année en France . Ces montants ne sont pas dus à une absence de besoin, mais bien à un système qui exclut une part importante de la population vulnérable.
Les raisons du non-recours sont bien connues. La complexité des démarches administratives, le manque d’information, la dématérialisation des services, les barrières linguistiques ou encore la peur de stigmatisation en sont les principales causes. De nombreuses personnes ignorent qu’elles sont éligibles, d’autres sont découragées par la lourdeur des procédures ou redoutent les contrôles et les régularisations. Certaines, enfin, refusent de demander une aide par souci de dignité ou de peur d’être perçues comme des « assistées ».
Autrement dit, loin de l’image d’un prétendu assistanat généralisé, la réalité française est celle d’un système qui laisse de côté une partie des plus pauvres. Ce non-recours, silencieux et invisible, permet à l’État d’économiser des milliards d’euros chaque année sur le dos des plus fragiles, tout en alimentant les fantasmes politiques autour d’un prétendu excès d’aides.
(Photo OP)
Notre site est accessible, sans abonnement, sans mur payant, sans publicité, parce que nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent lire et partager nos articles.
Mais ce choix a une contrepartie : sans vos dons, déductibles des impôts,
Le Nouveau Paradigme ne peut pas exister.
Nous dépendons donc exclusivement du soutien de nos lectrices et lecteurs.